Syriza, un parti de gauche radicale dont la popularité a grimpé en flèche sur fond de la crise économique du pays, est le favori dans les sondages, mais il est peu probable qu’il gagne assez de sièges parlementaires pour gouverner seul. Par contre, il dirigera probablement un gouvernement de coalition, dont les autres parties restent incertaines.
Le thème économique est fondamental dans le programme de Syriza, conçu pour contrecarrer l'impact de l'austérité trop stricte que les Grecs ont enduré pendant les quatre dernières années et demi, en échange des plans de sauvetage de la « troïka » formée par la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international Fonds et la Commission européenne. Les pensions ont été réduites de 40%, en moyenne, tandis que la classe moyenne souffre sous le poids de nouveaux impôts fonciers paralysants.
En conséquence, la Grèce est tombée dans une récession profonde et prolongée, avec une production en baisse de 25% par rapport aux niveaux d’avant crise. Pire, le chômage s’élève à près de 26% - et dépasse 50% chez les jeunes. Pourtant, la plupart des allocations de chômage sont maintenant éliminées après 12 mois, et les chômeurs de longue durée perdent souvent l'accès au système de soins de santé public. Ajoutez à cela une augmentation de 30% du prix des médicaments d'ordonnance, et il est facile de voir pourquoi la société grecque est en train de se déliter.
Bien sûr, ces sacrifices pourraient être utiles s’ils aidaient la Grèce à réduire sa dette publique à des niveaux gérables. Pourtant, à la fin de 2014, la dette publique s’élevait à 175% du PIB, en augmentation par rapport à son niveau de 127% en 2009. Le service de la dette exigerait des excédents budgétaires primaires au moins équivalents à 4% du PIB jusqu'en 2022 – ce qui exigerait une forte hausse de la croissance. Or, sous le poids de l'austérité budgétaire implacable, cette croissance est hors de question.
C’est pourquoi Syriza a promis de lancer un nouveau programme de dépenses massives – y compris la gratuité de l’électricité et la distribution de bons alimentaires pour les plus pauvres et une augmentation des pensions publiques aux niveaux d'avant crise – ce qui coûterait environ 6,5% du PIB. Des hausses d'impôts pour les salariés à revenu élevé et les grands propriétaires aideraient à financer ces dépenses, tandis que des augmentations du salaire minimum viendraient compléter les efforts de redistribution des revenus.
Syriza a également promis d'abroger la libéralisation du marché du travail et de suspendre la privatisation. Enfin, il envisage de renégocier la dette de la Grèce avec les prêteurs, dans l'espoir d’annuler la majeure partie de ses passifs.
Le programme économique de Syriza néglige un fait important : la consolidation budgétaire et les mesures structurelles font non seulement partie des engagements de la Grèce, mais servent aussi l'intérêt à long terme du pays. Compte tenu de cela, ils ne peuvent pas – et ne doivent pas – être abolis. Par contre, les problèmes dans leur conception et leur mise en œuvre doivent être solutionnés, afin d'améliorer leur efficacité dans les circonstances économiques actuelles.
Une telle approche permettrait de renforcer la position de Syriza dans les négociations en vue d’un allégement de la dette. Néanmoins, les déclarations officielles suggèrent que la troïka ne serait pas encline à accepter le cadre de négociation de Syriza. Elle aurait au contraire l’intention d'achever les pourparlers entamés avec le gouvernement de centre-droit sortant, dans le but d'obtenir de nouvelles coupes budgétaires et de lancer de nouvelles réformes du marché du travail et des retraites. En bref, la troïka va insister pour que la Grèce honore ses engagements antérieurs.
Si les négociations stagnent, les risques financiers et de liquidité, résultant de l'incapacité de la Grèce d'emprunter aux taux d'intérêt actuels – les rendements obligataires à dix ans ont atteint 9,5% – affaibliront encore plus la situation budgétaire et le système bancaire du pays. Cela pourrait conduire à un effondrement de la confiance, déclenchant des bouleversements financiers et obligeant finalement le pays à briguer un troisième plan de sauvetage – qui obligerait la Grèce à quitter la zone euro et à introduire une nouvelle monnaie dévaluée.
Dans ce cas, la position géopolitique de la Grèce serait affaiblie, son économie s’enfoncerait davantage dans la récession et les tensions sociales se renforceraient. En outre, l'instabilité deviendrait chronique, parce que la zone euro n’offrirait plus de filet de sécurité au laxisme budgétaire et financier.
Les autorités de la zone euro peuvent déclarer qu'une sortie de la Grèce ne représente désormais plus un risque systémique, compte tenu de l'introduction au cours des dernières années de divers instruments pour lutter contre les crises financières, y compris les fonds de secours soutenus par les gouvernements, une union bancaire partielle, des contrôles fiscaux plus sévères et le nouveau rôle de prêteur en dernier recours de la Banque centrale européenne. Néanmoins, la sortie d'un membre indiquerait que l'intégrité de la zone euro n’est pas garantie – un message que les marchés ne manqueront probablement pas de remarquer.
Une sortie de la Grèce pourrait servir d'avertissement à des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France, où de forts partis anti-européens ou anti-établishement sont en hausse. Mais elle ne ferait rien pour régler le vrai problème : la divergence économique croissante entre les pays de la zone euro. Tant que les écarts de rendement continuent de se creuser, les électeurs continueront à contester l'intégration européenne. Seule une unification plus poussée, soutenue par des politiques axées sur la croissance dans les pays en difficulté, peut inverser cette tendance.
Un tel résultat est encore possible – mais seulement si les acteurs concernés reconnaissent les risques associés à une sortie de la Grèce de la zone euro. Un gouvernement dirigé par Syriza doit modérer son approche et promettre qu'il continuera de poursuivre les réformes et de limiter les dépenses en échange d'une réduction substantielle de sa dette – une réduction que la troïka doit être disposée à accorder.
Traduit de l’anglais par Timothée Demont
Yannos Papantoniou, ancien ministre grec de l'Economie et des Finances, est président du Center for Progressive Policy Research.
Le thème économique est fondamental dans le programme de Syriza, conçu pour contrecarrer l'impact de l'austérité trop stricte que les Grecs ont enduré pendant les quatre dernières années et demi, en échange des plans de sauvetage de la « troïka » formée par la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international Fonds et la Commission européenne. Les pensions ont été réduites de 40%, en moyenne, tandis que la classe moyenne souffre sous le poids de nouveaux impôts fonciers paralysants.
En conséquence, la Grèce est tombée dans une récession profonde et prolongée, avec une production en baisse de 25% par rapport aux niveaux d’avant crise. Pire, le chômage s’élève à près de 26% - et dépasse 50% chez les jeunes. Pourtant, la plupart des allocations de chômage sont maintenant éliminées après 12 mois, et les chômeurs de longue durée perdent souvent l'accès au système de soins de santé public. Ajoutez à cela une augmentation de 30% du prix des médicaments d'ordonnance, et il est facile de voir pourquoi la société grecque est en train de se déliter.
Bien sûr, ces sacrifices pourraient être utiles s’ils aidaient la Grèce à réduire sa dette publique à des niveaux gérables. Pourtant, à la fin de 2014, la dette publique s’élevait à 175% du PIB, en augmentation par rapport à son niveau de 127% en 2009. Le service de la dette exigerait des excédents budgétaires primaires au moins équivalents à 4% du PIB jusqu'en 2022 – ce qui exigerait une forte hausse de la croissance. Or, sous le poids de l'austérité budgétaire implacable, cette croissance est hors de question.
C’est pourquoi Syriza a promis de lancer un nouveau programme de dépenses massives – y compris la gratuité de l’électricité et la distribution de bons alimentaires pour les plus pauvres et une augmentation des pensions publiques aux niveaux d'avant crise – ce qui coûterait environ 6,5% du PIB. Des hausses d'impôts pour les salariés à revenu élevé et les grands propriétaires aideraient à financer ces dépenses, tandis que des augmentations du salaire minimum viendraient compléter les efforts de redistribution des revenus.
Syriza a également promis d'abroger la libéralisation du marché du travail et de suspendre la privatisation. Enfin, il envisage de renégocier la dette de la Grèce avec les prêteurs, dans l'espoir d’annuler la majeure partie de ses passifs.
Le programme économique de Syriza néglige un fait important : la consolidation budgétaire et les mesures structurelles font non seulement partie des engagements de la Grèce, mais servent aussi l'intérêt à long terme du pays. Compte tenu de cela, ils ne peuvent pas – et ne doivent pas – être abolis. Par contre, les problèmes dans leur conception et leur mise en œuvre doivent être solutionnés, afin d'améliorer leur efficacité dans les circonstances économiques actuelles.
Une telle approche permettrait de renforcer la position de Syriza dans les négociations en vue d’un allégement de la dette. Néanmoins, les déclarations officielles suggèrent que la troïka ne serait pas encline à accepter le cadre de négociation de Syriza. Elle aurait au contraire l’intention d'achever les pourparlers entamés avec le gouvernement de centre-droit sortant, dans le but d'obtenir de nouvelles coupes budgétaires et de lancer de nouvelles réformes du marché du travail et des retraites. En bref, la troïka va insister pour que la Grèce honore ses engagements antérieurs.
Si les négociations stagnent, les risques financiers et de liquidité, résultant de l'incapacité de la Grèce d'emprunter aux taux d'intérêt actuels – les rendements obligataires à dix ans ont atteint 9,5% – affaibliront encore plus la situation budgétaire et le système bancaire du pays. Cela pourrait conduire à un effondrement de la confiance, déclenchant des bouleversements financiers et obligeant finalement le pays à briguer un troisième plan de sauvetage – qui obligerait la Grèce à quitter la zone euro et à introduire une nouvelle monnaie dévaluée.
Dans ce cas, la position géopolitique de la Grèce serait affaiblie, son économie s’enfoncerait davantage dans la récession et les tensions sociales se renforceraient. En outre, l'instabilité deviendrait chronique, parce que la zone euro n’offrirait plus de filet de sécurité au laxisme budgétaire et financier.
Les autorités de la zone euro peuvent déclarer qu'une sortie de la Grèce ne représente désormais plus un risque systémique, compte tenu de l'introduction au cours des dernières années de divers instruments pour lutter contre les crises financières, y compris les fonds de secours soutenus par les gouvernements, une union bancaire partielle, des contrôles fiscaux plus sévères et le nouveau rôle de prêteur en dernier recours de la Banque centrale européenne. Néanmoins, la sortie d'un membre indiquerait que l'intégrité de la zone euro n’est pas garantie – un message que les marchés ne manqueront probablement pas de remarquer.
Une sortie de la Grèce pourrait servir d'avertissement à des pays comme l'Espagne, l'Italie et la France, où de forts partis anti-européens ou anti-établishement sont en hausse. Mais elle ne ferait rien pour régler le vrai problème : la divergence économique croissante entre les pays de la zone euro. Tant que les écarts de rendement continuent de se creuser, les électeurs continueront à contester l'intégration européenne. Seule une unification plus poussée, soutenue par des politiques axées sur la croissance dans les pays en difficulté, peut inverser cette tendance.
Un tel résultat est encore possible – mais seulement si les acteurs concernés reconnaissent les risques associés à une sortie de la Grèce de la zone euro. Un gouvernement dirigé par Syriza doit modérer son approche et promettre qu'il continuera de poursuivre les réformes et de limiter les dépenses en échange d'une réduction substantielle de sa dette – une réduction que la troïka doit être disposée à accorder.
Traduit de l’anglais par Timothée Demont
Yannos Papantoniou, ancien ministre grec de l'Economie et des Finances, est président du Center for Progressive Policy Research.
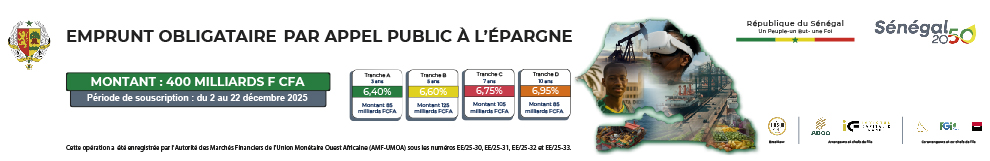

 chroniques
chroniques





















