Pour de nombreux membres de l’Union économique et monétaire (UEM), la décision d’octroyer l’indépendance à leur banque centrale afin de rejoindre la zone euro impliquait un changement de régime politique. Ainsi l’indépendance de la Banque de France, lors du référendum de ratification du traité de Maastricht, en 1992, fut-elle l’un des arguments les plus forts de la campagne contre l’adhésion à l’euro.
Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, en revanche, c’est devenu monnaie courante, si l’on peut dire, de faire pression sur la banque centrale. Depuis quelques mois, même le ministre des Finances, Wolgang Schaüble commente régulièrement la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).
Les interventions de Schaüble s’en prennent au cœur même de ce qui constitue l’indépendance de la banque centrale. S’il ne cherche pas à redéfinir l’objectif de la politique monétaire (cette « norme des prix », dans l’ancien jargon de la Bundesbank), il n’en prodigue pas moins ses conseils quant aux outils dont la BCE devrait faire usage et à la façon dont elle doit les manier pour atteindre un tel but.
On connaît des précédents. En 1998, Oskar Lafontaine, alors ministre des Finance de l’Allemagne, y alla de ses bons conseils au premier président de la BCE, Wim Duisenberg, sur la façon de conduire la politique monétaire (l’objectif de la Lafontaine était de créer, in fine, une zone cible pour les taux de change). Duisenberg, avec un laconisme tout néerlandais, lui répondit qu’il n’y avait rien d’incongru à ce qu’un homme politique fasse part de son opinion sur la politique monétaire (en Allemagne, c’était absolument inhabituel). « Pourtant – ajouta-t-il –, il serait tout à fait anormal qu’on tienne compte de [ses] suggestions. »
Le respect de l’indépendance de la politique monétaire est depuis longtemps un élément central de la Stabilitätkultur (« culture de la stabilité ») allemande. L’acte fondateur de la réputation de stricte indépendance acquise par la Bundesbank fut son refus de céder aux exhortations du chancelier Konrad Adenauer, qui souhaitait qu’elle contienne la hausse des taux d’intérêt, en 1956. À cette époque, la France ne voyait pas les choses de la même façon. Charles de Gaulle était sur le point de créer la Ve République, avec une Banque de France qui rendait compte au ministre des Finances.
Mais c’était un autre temps. Suite aux différentes crises qui ont secoué l’UEM, la politique monétaire a de plus en plus tendance à remplacer la politique budgétaire. Le vieux dogme serait-il devenu caduc ?
L’Europe demeure très vulnérable ; l’habitant médian de l’UEM a déjà perdu dix ans et, ce qui est encore plus inquiétant, nous sommes proches de la situation critique. Les États-Unis, pourtant, font mieux. Nonobstant un blocage politique difficile à gérer, ils sont parvenus à s’attaquer au problème macro-économique (la faiblesse de la demande globale) auquel ils étaient confrontés en lançant des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes.
Les États-Unis ont également mieux géré leurs problèmes bancaires, qui, au départ, étaient bien plus graves qu’en Europe. (Il y a évidemment une forte interaction entre les mesures qui peuvent être prises dans les deux domaines. Plus une économie est robuste, plus ses banques sont profitables et plus elles sont capables de remplir leur fonction : financer l’économie.)
Mais l’indépendance de la BCE est moins menacée par les bons conseils d’un ministre des Finances que par le manque de soutien des populations. Et de fait, la célèbre autonomie de la Bundesbank s’appuyait moins sur son statut juridique que sur l’indéfectible soutien (justifié par ses performances) des citoyens allemands.
Il en va exactement du contraire avec la BCE. Des voix se font entendre, notamment en Allemagne, pour la soumettre à davantage de pressions. Mais la plus grande menace à l’autonomie de la BCE tient au fardeau insupportable qui pèse sur ses épaules. Moins la politique budgétaire est sollicitée pour stabiliser la production, plus les banques centrales sont de facto contraintes de prendre à leur charge cet objectif (à moins, évidemment, qu’elles ne soient conçues pour laisser faire la nature, et permettre que l’économie ne s’englue dans la stagnation, voire pire).
Le résultat politique de cet enchaînement est une régression très nette vers le nationalisme, de droite comme de gauche, dans tous les pays de l’UEM, y compris l’Allemagne. La montée du nationalisme est presque un corollaire logique des politiques poursuivies. Elle est endogène.
Et là aussi, l’Allemagne mène la danse, avec son obsession du schwarze Null, de l’équilibre budgétaire, contre vents et marées. En Allemagne, les déficits sont mal vus, d’un point de vue non seulement arithmétique, mais aussi moral, même si cela défie le bon sens économique et ressemble à du clientélisme.
À la fin du XIXe siècle, les principaux spécialistes allemands des finances publiques, dont Albert Schäffle et Adolph Wagner, forgèrent une « règle d’or » selon laquelle les dépenses courantes doivent être financées, en moyenne, par les recettes courantes. Les dépenses publiques, et les ressources qu’elles nécessitent, se justifient par leur utilité. Ce qui revient à dire que les investissements destinés à améliorer la productivité – les dépenses d’équipement – peuvent être financés avec de la dette, dont le service est assuré par la croissance des revenus et de l’assiette des recettes associées.
Cette ligne de conduite classique a été institutionnalisée dans un concept utile : la distinction entre dépenses courantes et dépenses d’investissement, qu’on pratique toujours en niveau municipal en Allemagne (et en Autriche). C’est capital, parce qu’en Allemagne, 50% environ des dépenses d’investissement du secteur public sont gérées à ce niveau (proportion en baisse, puisque la part municipale était des deux tiers au début des années 1990). Ces dépenses sont cohérentes avec le soutien de la compétitivité des petites et moyennes entreprises allemandes (mittlestand). Mais par rapport au début des années 1990 et à prix constants, les dépenses d’investissement ont baissé d’environ 15%. Voici plus d’une décennie, qu’elles sont insuffisantes au maintien du stock de capital. Si ce n’est pas ainsi qu’on prépare l’avenir, c’est ainsi qu’on sape la productivité et la prospérité.
En bref, le schwarze Null va à l’encontre du but recherché. Les infrastructures vétustes (certes pas autant qu’aux États-Unis) sont devenues pour l’Allemagne un problème réel. En outre, la frugalité budgétaire des dirigeants allemands déborde les frontières allemandes et ses effets sont amplifiés par l’union monétaire, qui ne dispose pas de taux de change pour acclimater les particularismes nationaux.
Bien sûr, l’union monétaire européenne est imparfaite. Mais transformer en bouc émissaire la seule institution prête à « faire ce qu’il faut » pour ramener l’UEM sur ses rails est une fort mauvaise idée. Que les États utilisent, où il existe, l’espace budgétaire dont ils disposent pour relâcher la pression sur la BCE serait une bien meilleure stratégie. L’Allemagne, sans aucun doute, jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre.
Traduction François Boisivon
Hanz-Helmut Kotz est professeur d’économie invité à l’université Harvard et chercheur associé au Centre d’études financières de l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main.
Dans l’Allemagne d’aujourd’hui, en revanche, c’est devenu monnaie courante, si l’on peut dire, de faire pression sur la banque centrale. Depuis quelques mois, même le ministre des Finances, Wolgang Schaüble commente régulièrement la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).
Les interventions de Schaüble s’en prennent au cœur même de ce qui constitue l’indépendance de la banque centrale. S’il ne cherche pas à redéfinir l’objectif de la politique monétaire (cette « norme des prix », dans l’ancien jargon de la Bundesbank), il n’en prodigue pas moins ses conseils quant aux outils dont la BCE devrait faire usage et à la façon dont elle doit les manier pour atteindre un tel but.
On connaît des précédents. En 1998, Oskar Lafontaine, alors ministre des Finance de l’Allemagne, y alla de ses bons conseils au premier président de la BCE, Wim Duisenberg, sur la façon de conduire la politique monétaire (l’objectif de la Lafontaine était de créer, in fine, une zone cible pour les taux de change). Duisenberg, avec un laconisme tout néerlandais, lui répondit qu’il n’y avait rien d’incongru à ce qu’un homme politique fasse part de son opinion sur la politique monétaire (en Allemagne, c’était absolument inhabituel). « Pourtant – ajouta-t-il –, il serait tout à fait anormal qu’on tienne compte de [ses] suggestions. »
Le respect de l’indépendance de la politique monétaire est depuis longtemps un élément central de la Stabilitätkultur (« culture de la stabilité ») allemande. L’acte fondateur de la réputation de stricte indépendance acquise par la Bundesbank fut son refus de céder aux exhortations du chancelier Konrad Adenauer, qui souhaitait qu’elle contienne la hausse des taux d’intérêt, en 1956. À cette époque, la France ne voyait pas les choses de la même façon. Charles de Gaulle était sur le point de créer la Ve République, avec une Banque de France qui rendait compte au ministre des Finances.
Mais c’était un autre temps. Suite aux différentes crises qui ont secoué l’UEM, la politique monétaire a de plus en plus tendance à remplacer la politique budgétaire. Le vieux dogme serait-il devenu caduc ?
L’Europe demeure très vulnérable ; l’habitant médian de l’UEM a déjà perdu dix ans et, ce qui est encore plus inquiétant, nous sommes proches de la situation critique. Les États-Unis, pourtant, font mieux. Nonobstant un blocage politique difficile à gérer, ils sont parvenus à s’attaquer au problème macro-économique (la faiblesse de la demande globale) auquel ils étaient confrontés en lançant des politiques budgétaire et monétaire expansionnistes.
Les États-Unis ont également mieux géré leurs problèmes bancaires, qui, au départ, étaient bien plus graves qu’en Europe. (Il y a évidemment une forte interaction entre les mesures qui peuvent être prises dans les deux domaines. Plus une économie est robuste, plus ses banques sont profitables et plus elles sont capables de remplir leur fonction : financer l’économie.)
Mais l’indépendance de la BCE est moins menacée par les bons conseils d’un ministre des Finances que par le manque de soutien des populations. Et de fait, la célèbre autonomie de la Bundesbank s’appuyait moins sur son statut juridique que sur l’indéfectible soutien (justifié par ses performances) des citoyens allemands.
Il en va exactement du contraire avec la BCE. Des voix se font entendre, notamment en Allemagne, pour la soumettre à davantage de pressions. Mais la plus grande menace à l’autonomie de la BCE tient au fardeau insupportable qui pèse sur ses épaules. Moins la politique budgétaire est sollicitée pour stabiliser la production, plus les banques centrales sont de facto contraintes de prendre à leur charge cet objectif (à moins, évidemment, qu’elles ne soient conçues pour laisser faire la nature, et permettre que l’économie ne s’englue dans la stagnation, voire pire).
Le résultat politique de cet enchaînement est une régression très nette vers le nationalisme, de droite comme de gauche, dans tous les pays de l’UEM, y compris l’Allemagne. La montée du nationalisme est presque un corollaire logique des politiques poursuivies. Elle est endogène.
Et là aussi, l’Allemagne mène la danse, avec son obsession du schwarze Null, de l’équilibre budgétaire, contre vents et marées. En Allemagne, les déficits sont mal vus, d’un point de vue non seulement arithmétique, mais aussi moral, même si cela défie le bon sens économique et ressemble à du clientélisme.
À la fin du XIXe siècle, les principaux spécialistes allemands des finances publiques, dont Albert Schäffle et Adolph Wagner, forgèrent une « règle d’or » selon laquelle les dépenses courantes doivent être financées, en moyenne, par les recettes courantes. Les dépenses publiques, et les ressources qu’elles nécessitent, se justifient par leur utilité. Ce qui revient à dire que les investissements destinés à améliorer la productivité – les dépenses d’équipement – peuvent être financés avec de la dette, dont le service est assuré par la croissance des revenus et de l’assiette des recettes associées.
Cette ligne de conduite classique a été institutionnalisée dans un concept utile : la distinction entre dépenses courantes et dépenses d’investissement, qu’on pratique toujours en niveau municipal en Allemagne (et en Autriche). C’est capital, parce qu’en Allemagne, 50% environ des dépenses d’investissement du secteur public sont gérées à ce niveau (proportion en baisse, puisque la part municipale était des deux tiers au début des années 1990). Ces dépenses sont cohérentes avec le soutien de la compétitivité des petites et moyennes entreprises allemandes (mittlestand). Mais par rapport au début des années 1990 et à prix constants, les dépenses d’investissement ont baissé d’environ 15%. Voici plus d’une décennie, qu’elles sont insuffisantes au maintien du stock de capital. Si ce n’est pas ainsi qu’on prépare l’avenir, c’est ainsi qu’on sape la productivité et la prospérité.
En bref, le schwarze Null va à l’encontre du but recherché. Les infrastructures vétustes (certes pas autant qu’aux États-Unis) sont devenues pour l’Allemagne un problème réel. En outre, la frugalité budgétaire des dirigeants allemands déborde les frontières allemandes et ses effets sont amplifiés par l’union monétaire, qui ne dispose pas de taux de change pour acclimater les particularismes nationaux.
Bien sûr, l’union monétaire européenne est imparfaite. Mais transformer en bouc émissaire la seule institution prête à « faire ce qu’il faut » pour ramener l’UEM sur ses rails est une fort mauvaise idée. Que les États utilisent, où il existe, l’espace budgétaire dont ils disposent pour relâcher la pression sur la BCE serait une bien meilleure stratégie. L’Allemagne, sans aucun doute, jouit à cet égard d’une certaine marge de manœuvre.
Traduction François Boisivon
Hanz-Helmut Kotz est professeur d’économie invité à l’université Harvard et chercheur associé au Centre d’études financières de l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main.
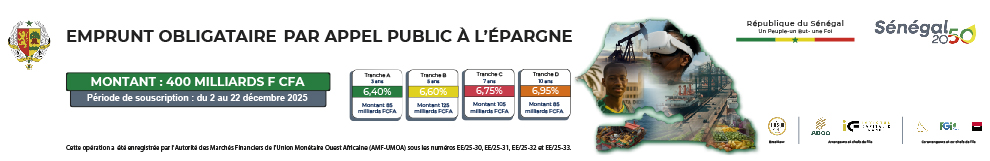

 chroniques
chroniques





















