En mai 2010, le gouvernement grec a consenti à un ajustement budgétaire s’élevant à 16 % de son PIB sur la période 2010 à 2013. La Grèce est ainsi parvenue à passer d’un déficit budgétaire primaire (exclusion faite des paiements d’intérêts sur la dette) de plus de 10 % du PIB à un solde primaire l’an dernier – soit la plus importante inversion observée en Europe depuis la crise.
Le FMI avait initialement prévu que le PIB réel de la Grèce (ajusté à l’inflation) subirait une contraction d’environ 5 % sur la période 2010-2011, qu’il se stabiliserait en 2012, et qu’il se remettrait ensuite à augmenter. En réalité, ce PIB réel a chuté de 25 %, et n’a jamais pu remonter la pente. De plus, dans la mesure où le PIB nominal a diminué à partir de 2014, et continue de décliner, le ratio dette/PIB, qui était censé se stabiliser il y a trois ans, continue d’augmenter.
Blanchard relève qu’en 2012 la Grèce avait accepté de « générer un excédent primaire suffisant pour limiter son endettement, » et de mettre en œuvre « un certain nombre de réformes permettant une plus forte croissance ». Ces soi-disant réformes ont fait intervenir une baisse importante des dépenses publiques, plusieurs réductions du salaire minimum, un certain nombre de privatisations au rabais, la fin des négociations collectives, ainsi que de sévères réductions des retraites. Autant de mesures que la Grèce a bel et bien honorées, ce qui n’a pas empêché la dépression de persister.
Le FMI et les autres créanciers de la Grèce ont choisi de croire en l’hypothèse selon laquelle l’importante contraction budgétaire n’engendrerait qu’un effet temporaire sur l’activité économique, l’emploi, et les impôts, et que les coupes effectuées sur les salaires, les retraites et les emplois publics auraient quant à elles un effet magique sur la croissance. Cette hypothèse s’est révélée fausse. En effet, l’ajustement effectué par la Grèce après 2010 a abouti à une véritable catastrophe économique – mettant en lumière les prévisions les plus erronées qu’ai jamais formulées le FMI.
Ainsi s’attendrait-on désormais à ce que Blanchard cesse de prolonger ce fiasco. En effet, une fois rompu le lien entre « réforme » et croissance – comme c’est le cas en Grèce – l’argumentation de l’économiste en chef s’effondre. En l’absence de perspective de croissance, le fait pour les créanciers d’exiger au final un excédent primaire de 3,5 % du PIB revient en réalité à favoriser une contraction encore plus importante, débutant par une nouvelle crise grave cette année.
Or, plutôt que d’admettre cette réalité et de s’y adapter en conséquence, Blanchard choisit de s’attaquer encore davantage aux retraites, en déclarant :
« Pourquoi insister sur les retraites ? Avec les salaires, elles représentent environ 75 % des dépenses primaires ; les 25 % restants ont d’ores et déjà été réduits à leur plus simple expression. Les retraites constituent plus de 16 % du PIB, et les transferts du budget vers le système des retraites sont proches de 10 % du PIB. Nous estimons qu’il faut réduire les dépenses de retraites de 1 % du PIB (sur 16 %), et qu’il est possible de le faire tout en protégeant les retraités les plus démunis. »
Notons cette première admission accablante : à l’exception des retraites et des salaires, les dépenses auraient d’ores et déjà été « réduites à leur plus simple expression ». Souvenons-nous également : l’effet de cette approche sur la croissance s’est révélé négatif. Ainsi, négligeant des éléments de preuve pourtant évidents, le FMI entend désormais cibler le dernier secteur restant, celui des retraites, qui a d’ores et déjà subi des réductions considérables – bien souvent plus de 40 %. Ces nouvelles coupes aujourd’hui envisagées viendraient frapper durement les plus démunis.
Si le paiement des retraites représente aujourd’hui 16 % du PIB grec, c’est précisément parce que l’économie de la Grèce se trouve contractée de 25 % par rapport à 2009. Si n’avaient pas eu lieu cinq années d’austérité désastreuse, le PIB grec serait peut-être supérieur de 33 % à ce qu’il est aujourd’hui, et les retraites ne représenteraient que 12 % du PIB, au lieu des 16 % actuels. L’équation est pour le moins simple.
Blanchard appelle le gouvernement de la Grèce à proposer des « mesures véritablement crédibles ». Mais le FMI ne devrait-il pas en faire de même ? Pour diminuer les retraites d’un point de pourcentage du PIB, une croissance économique nominale de seulement 4 % par an, pendant deux ans, se révélerait suffisante – sans coupes supplémentaires. Pourquoi ne pas entreprendre des « mesures crédibles » afin d’atteindre cet objectif ?
Ceci nous amène à la question de la dette grecque. Comme chacun le sait au FMI, l’existence d’un surendettement constitue un importantpassif non capitalisé qui revient à dire aux investisseurs : entrez à vos risques et périls. À tout moment, vos investissements, vos bénéfices et votre travail acharné peuvent se retrouver taxés et dérobés afin de nourrir le cadavre de prêteurs passés. Le surendettement constitue un véritable barrage à la croissance. C’est la raison pour laquelle toutes les crises de la dette se terminent tôt ou tard en restructuration ou en défaut de paiement.
Blanchard est un pionnier de l’économie de la dette publique. L’économiste en chef sait pertinemment que la dette grecque n’a jamais été tenable à quelque période au cours des cinq dernières années, pas plus qu’elle ne l’est aujourd’hui. C’est là un point sur lequel sont d’accord la Grèce et le FMI.
Il se trouve que la Grèce formule en réalité une proposition crédible concernant sa dette. Tout d’abord, laissez le Mécanisme européen de stabilisation (MES) effectuer un prêt de 27 milliards €, sur des échéances étendues, afin de retirer les obligations grecques que la Banque centrale européenne a bêtement acquises en 2010. Deuxièmement, consacrez les rendements de ces obligations au paiement du FMI. Enfin, faites participer la Grèce au programme d’assouplissement quantitatif de la BCE, ce qui permettrait au pays de faire son retour sur les marchés.
La Grèce est prête à accepter des conditions justes dans le cadre d’un prêt du MES. Elle ne demande pas un centime de financement public supplémentaire en faveur de l’État grec. Elle promet de toujours vivre dans la limite de ses moyens, ainsi que de se fonder sur ses épargnes intérieures et sur des investissements extérieurs pour promouvoir sa croissance – des exigences bien en-dessous de ce que n’importe quel autre grand pays, au contrôle de sa propre monnaie, entreprendrait face à un désastre comparable.
Blanchard insiste aujourd’hui sur la nécessité de « faire des choix difficiles de part et d’autre ». Une nécessité incontestable. Pour autant, les Grecs ont d’ores et déjà procédé à des choix difficiles. C’est désormais au FMI d’agir, en commençant par admettre combien les politiques imposées pendant cinq ans ont généré une véritable catastrophe. Du côté des autres créanciers, ce choix pénible doit consister à admettre qu’il est nécessaire de restructurer les dettes grecques – comme le sait pertinemment le FMI. Car la proposition d’octroi de nouveaux prêts en direction de politiques défaillantes – actuelle proposition conjointe des créanciers – ne représente pour eux aucun véritable effort d’ajustement.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
James K. Galbraith, auteur de l’ouvrage intitulé The End of Normal , est professeur à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l’Université du Texas.
Le FMI avait initialement prévu que le PIB réel de la Grèce (ajusté à l’inflation) subirait une contraction d’environ 5 % sur la période 2010-2011, qu’il se stabiliserait en 2012, et qu’il se remettrait ensuite à augmenter. En réalité, ce PIB réel a chuté de 25 %, et n’a jamais pu remonter la pente. De plus, dans la mesure où le PIB nominal a diminué à partir de 2014, et continue de décliner, le ratio dette/PIB, qui était censé se stabiliser il y a trois ans, continue d’augmenter.
Blanchard relève qu’en 2012 la Grèce avait accepté de « générer un excédent primaire suffisant pour limiter son endettement, » et de mettre en œuvre « un certain nombre de réformes permettant une plus forte croissance ». Ces soi-disant réformes ont fait intervenir une baisse importante des dépenses publiques, plusieurs réductions du salaire minimum, un certain nombre de privatisations au rabais, la fin des négociations collectives, ainsi que de sévères réductions des retraites. Autant de mesures que la Grèce a bel et bien honorées, ce qui n’a pas empêché la dépression de persister.
Le FMI et les autres créanciers de la Grèce ont choisi de croire en l’hypothèse selon laquelle l’importante contraction budgétaire n’engendrerait qu’un effet temporaire sur l’activité économique, l’emploi, et les impôts, et que les coupes effectuées sur les salaires, les retraites et les emplois publics auraient quant à elles un effet magique sur la croissance. Cette hypothèse s’est révélée fausse. En effet, l’ajustement effectué par la Grèce après 2010 a abouti à une véritable catastrophe économique – mettant en lumière les prévisions les plus erronées qu’ai jamais formulées le FMI.
Ainsi s’attendrait-on désormais à ce que Blanchard cesse de prolonger ce fiasco. En effet, une fois rompu le lien entre « réforme » et croissance – comme c’est le cas en Grèce – l’argumentation de l’économiste en chef s’effondre. En l’absence de perspective de croissance, le fait pour les créanciers d’exiger au final un excédent primaire de 3,5 % du PIB revient en réalité à favoriser une contraction encore plus importante, débutant par une nouvelle crise grave cette année.
Or, plutôt que d’admettre cette réalité et de s’y adapter en conséquence, Blanchard choisit de s’attaquer encore davantage aux retraites, en déclarant :
« Pourquoi insister sur les retraites ? Avec les salaires, elles représentent environ 75 % des dépenses primaires ; les 25 % restants ont d’ores et déjà été réduits à leur plus simple expression. Les retraites constituent plus de 16 % du PIB, et les transferts du budget vers le système des retraites sont proches de 10 % du PIB. Nous estimons qu’il faut réduire les dépenses de retraites de 1 % du PIB (sur 16 %), et qu’il est possible de le faire tout en protégeant les retraités les plus démunis. »
Notons cette première admission accablante : à l’exception des retraites et des salaires, les dépenses auraient d’ores et déjà été « réduites à leur plus simple expression ». Souvenons-nous également : l’effet de cette approche sur la croissance s’est révélé négatif. Ainsi, négligeant des éléments de preuve pourtant évidents, le FMI entend désormais cibler le dernier secteur restant, celui des retraites, qui a d’ores et déjà subi des réductions considérables – bien souvent plus de 40 %. Ces nouvelles coupes aujourd’hui envisagées viendraient frapper durement les plus démunis.
Si le paiement des retraites représente aujourd’hui 16 % du PIB grec, c’est précisément parce que l’économie de la Grèce se trouve contractée de 25 % par rapport à 2009. Si n’avaient pas eu lieu cinq années d’austérité désastreuse, le PIB grec serait peut-être supérieur de 33 % à ce qu’il est aujourd’hui, et les retraites ne représenteraient que 12 % du PIB, au lieu des 16 % actuels. L’équation est pour le moins simple.
Blanchard appelle le gouvernement de la Grèce à proposer des « mesures véritablement crédibles ». Mais le FMI ne devrait-il pas en faire de même ? Pour diminuer les retraites d’un point de pourcentage du PIB, une croissance économique nominale de seulement 4 % par an, pendant deux ans, se révélerait suffisante – sans coupes supplémentaires. Pourquoi ne pas entreprendre des « mesures crédibles » afin d’atteindre cet objectif ?
Ceci nous amène à la question de la dette grecque. Comme chacun le sait au FMI, l’existence d’un surendettement constitue un importantpassif non capitalisé qui revient à dire aux investisseurs : entrez à vos risques et périls. À tout moment, vos investissements, vos bénéfices et votre travail acharné peuvent se retrouver taxés et dérobés afin de nourrir le cadavre de prêteurs passés. Le surendettement constitue un véritable barrage à la croissance. C’est la raison pour laquelle toutes les crises de la dette se terminent tôt ou tard en restructuration ou en défaut de paiement.
Blanchard est un pionnier de l’économie de la dette publique. L’économiste en chef sait pertinemment que la dette grecque n’a jamais été tenable à quelque période au cours des cinq dernières années, pas plus qu’elle ne l’est aujourd’hui. C’est là un point sur lequel sont d’accord la Grèce et le FMI.
Il se trouve que la Grèce formule en réalité une proposition crédible concernant sa dette. Tout d’abord, laissez le Mécanisme européen de stabilisation (MES) effectuer un prêt de 27 milliards €, sur des échéances étendues, afin de retirer les obligations grecques que la Banque centrale européenne a bêtement acquises en 2010. Deuxièmement, consacrez les rendements de ces obligations au paiement du FMI. Enfin, faites participer la Grèce au programme d’assouplissement quantitatif de la BCE, ce qui permettrait au pays de faire son retour sur les marchés.
La Grèce est prête à accepter des conditions justes dans le cadre d’un prêt du MES. Elle ne demande pas un centime de financement public supplémentaire en faveur de l’État grec. Elle promet de toujours vivre dans la limite de ses moyens, ainsi que de se fonder sur ses épargnes intérieures et sur des investissements extérieurs pour promouvoir sa croissance – des exigences bien en-dessous de ce que n’importe quel autre grand pays, au contrôle de sa propre monnaie, entreprendrait face à un désastre comparable.
Blanchard insiste aujourd’hui sur la nécessité de « faire des choix difficiles de part et d’autre ». Une nécessité incontestable. Pour autant, les Grecs ont d’ores et déjà procédé à des choix difficiles. C’est désormais au FMI d’agir, en commençant par admettre combien les politiques imposées pendant cinq ans ont généré une véritable catastrophe. Du côté des autres créanciers, ce choix pénible doit consister à admettre qu’il est nécessaire de restructurer les dettes grecques – comme le sait pertinemment le FMI. Car la proposition d’octroi de nouveaux prêts en direction de politiques défaillantes – actuelle proposition conjointe des créanciers – ne représente pour eux aucun véritable effort d’ajustement.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
James K. Galbraith, auteur de l’ouvrage intitulé The End of Normal , est professeur à la Lyndon B. Johnson School of Public Affairs de l’Université du Texas.
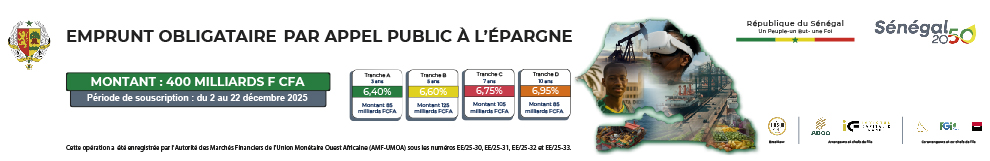

 chroniques
chroniques





















