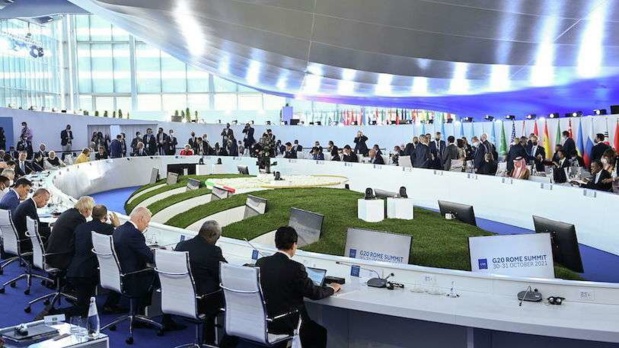En établissant un impôt mondial minimum de 15 %, payable par les sociétés où qu’elles opèrent, l’accord visait à la fois à dissuader les transferts de bénéfices via les paradis fiscaux, et à limiter les politiques du chacun pour soi dans l’attraction des investissements étrangers. Il introduisait également un impôt supplémentaire pour « environ 100 des plus grandes et plus rentables multinationales au monde, en veillant à ce que ces [sociétés] payent une juste part d’imposition, où qu’elles opèrent et génèrent des bénéfices ». L’objectif consistait à contraindre plusieurs géants technologiques tels qu’Amazon et Google à payer davantage d’impôts aux États dans lesquels étaient vendus leurs produits et services, peu importe que ces sociétés y soient physiquement présentes.
Seulement voilà, le consensus à l’appui de cet accord semble s’éroder. Si l’Union européenne et d’autres membres de l’OCDE ont commencé à mettre en œuvre l’impôt mondial minimum convenu, le Congrès des États-Unis a rejeté cette approche l’an dernier, par crainte de placer les entreprises américaines dans une position de désavantage concurrentiel. En vertu de l’Inflation Reduction Act, les États-Unis ont préféré opter pour un impôt minimum alternatif de 15 % uniquement sur les sociétés enregistrant plus d’un milliard de dollars de bénéfices pendant trois ans consécutifs – critère qui ne s’applique qu’à une poignée de multinationales américaines.
L’autre volet de l’accord – le mécanisme consistant à réorienter vers les pays signataires une faible part des bénéfices des plus grandes multinationales – appelle à un traité multilatéral contraignant. Impossible pour les États-Unis, puisque la ratification du moindre traité nécessite une majorité de deux tiers au Sénat. Les Républicains ont d’ores et déjà fait clairement savoir qu’ils s’opposeraient à tout nouvel impôt sur les multinationales américaines.
Or, même sans accord multilatéral formel, davantage de pays pourraient adopter unilatéralement d’autres mesures non permises par le cadre de 2021, telles qu’un impôt sur les services numériques. La Colombie et la Tanzanie ont récemment introduit des mesures de ce type. Les pays du Sud ont cruellement besoin de nouvelles sources de recettes fiscales, et nombre d’entre eux ont conclu que leurs préoccupations n’étaient pas suffisamment prises en compte dans le règlement négocié il y a deux ans, lorsque l’essentiel de l’attention semblait axé sur les intérêts des économies développées ainsi que de leurs multinationales. Aujourd'hui, le manque d’avancées en direction d’une pleine adoption affecte encore davantage leur confiance dans le processus.
La déception est si profonde que plusieurs pays africains ont proposé aux Nations Unies une résolution visant à lancer cette année une nouvelle phase de négociations intergouvernementales autour d’un impôt international. Dans le même temps, la Colombie, le Brésil et le Chili organisent des discussions sur une approche régionale commune.
Ces initiatives sont tout à fait compréhensibles. En vertu des règles actuelles, les multinationales parviennent aisément à échapper au paiement de leur juste part d’impôt, en enregistrant leurs bénéfices dans des juridictions faiblement imposées. Résultat, les gouvernements se retrouvent privés de recettes fiscales (à hauteur de 240 milliards $ chaque année), les entreprises locales doivent rivaliser selon des règles du jeu inéquitables contre des multinationales moins imposées qu’elles, de même que les travailleurs – aux revenus moins mobiles et plus faciles à auditer – doivent payer des impôts plus élevés puisque leur pays s’efforce de compenser les recettes non perçues.
L’accord de 2021 était censé mettre fin à tout cela. Le temps que les négociations s’achèvent, il avait néanmoins déjà été vidé de sa substance, au point de n’aboutir qu’à peu de recettes supplémentaires pour les pays en voie de développement.
L’impôt minimum était par exemple supposé être renforcé par un ensemble de règles imbriquées visant à déterminer quel État était en droit de taxer les bénéfices sous-imposés des multinationales. Seulement voilà, en pratique, l’organisation de ces règles a fait en sorte que l’essentiel des recettes soit collecté soit par les pays d’immatriculation (principalement les grandes économies développées), soit par des paradis fiscaux tels que l’Irlande, la Suisse ou Singapour, qui ont seulement fait passer à 15 % leurs taux d’imposition extraordinairement faibles.
Le passage d’un monde sans impôt minimum à un plancher de 15 % peut sembler constituer un pas en avant. Or, tout à toujours laissé à craindre que ce minimum peu élevé devienne la nouvelle norme, c’est-à-dire qu’une réforme censée placer plus haut la barre finisse en réalité par l’abaisser. Et dans la mesure où les pays en voie de développement recourent comparativement davantage aux recettes de l’impôt sur les sociétés, il était à prévoir que ces États finissent grands perdants.
La règle régissant par exemple la réorientation des droits de percevoir l’impôt ne s’appliquerait qu’à un petit nombre de multinationales, et à moins d’un quart de leurs bénéfices, l’essentiel des profits demeurant soumis à l’actuel régime des prix de transfert. Or, la raisonnement à l’appui de cette division demeure obscur, dans la mesure où les bénéfices d’entreprise déclarés dans la quasi-totalité des juridictions incluent déjà les déductions du coût du capital et des intérêts. Il s’agit de bénéfices purs résultant de l’exploitation conjointe des activités mondiales des multinationales.
Par conséquent, non seulement l’accord de 2021 mésentend-il l’économie de l’imposition des bénéfices des sociétés, mais il renforce également les inégalités mondiales en ne conférant que peu de recettes à des pays en voie de développement pourtant actuellement confrontés au parfait désastre d’une crise à la fois énergétique, alimentaire et de la dette. Le fait que les États prennent eux-mêmes les choses en main en dit long sur la fragilité du consensus actuel et sur la nécessité de davantage de réformes.
Les pays riches ont toujours eu tendance à entraver les efforts des pays en voie de développement visant à jouer un rôle actif dans la détermination des règles du jeu internationales. Autour de la table, il ne suffit pas de laisser un chaise libre aux représentants du Sud global. Ce qui importe, c’est que les autres négociateurs présents écoutent et répondent de manière significative à leurs préoccupations. Les dirigeants mondiaux doivent tenir compte des demandes des pays en voie de développement, et convenir d’une nouvelle ronde de négociations, plus inclusive, afin de parvenir à une réforme fiscale mondiale plus équitable et plus durable.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie, est professeur à l’Université de Columbia, et coprésident de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés. Tommaso Faccio est directeur du secrétariat de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés.
© Project Syndicate 1995–2023
Seulement voilà, le consensus à l’appui de cet accord semble s’éroder. Si l’Union européenne et d’autres membres de l’OCDE ont commencé à mettre en œuvre l’impôt mondial minimum convenu, le Congrès des États-Unis a rejeté cette approche l’an dernier, par crainte de placer les entreprises américaines dans une position de désavantage concurrentiel. En vertu de l’Inflation Reduction Act, les États-Unis ont préféré opter pour un impôt minimum alternatif de 15 % uniquement sur les sociétés enregistrant plus d’un milliard de dollars de bénéfices pendant trois ans consécutifs – critère qui ne s’applique qu’à une poignée de multinationales américaines.
L’autre volet de l’accord – le mécanisme consistant à réorienter vers les pays signataires une faible part des bénéfices des plus grandes multinationales – appelle à un traité multilatéral contraignant. Impossible pour les États-Unis, puisque la ratification du moindre traité nécessite une majorité de deux tiers au Sénat. Les Républicains ont d’ores et déjà fait clairement savoir qu’ils s’opposeraient à tout nouvel impôt sur les multinationales américaines.
Or, même sans accord multilatéral formel, davantage de pays pourraient adopter unilatéralement d’autres mesures non permises par le cadre de 2021, telles qu’un impôt sur les services numériques. La Colombie et la Tanzanie ont récemment introduit des mesures de ce type. Les pays du Sud ont cruellement besoin de nouvelles sources de recettes fiscales, et nombre d’entre eux ont conclu que leurs préoccupations n’étaient pas suffisamment prises en compte dans le règlement négocié il y a deux ans, lorsque l’essentiel de l’attention semblait axé sur les intérêts des économies développées ainsi que de leurs multinationales. Aujourd'hui, le manque d’avancées en direction d’une pleine adoption affecte encore davantage leur confiance dans le processus.
La déception est si profonde que plusieurs pays africains ont proposé aux Nations Unies une résolution visant à lancer cette année une nouvelle phase de négociations intergouvernementales autour d’un impôt international. Dans le même temps, la Colombie, le Brésil et le Chili organisent des discussions sur une approche régionale commune.
Ces initiatives sont tout à fait compréhensibles. En vertu des règles actuelles, les multinationales parviennent aisément à échapper au paiement de leur juste part d’impôt, en enregistrant leurs bénéfices dans des juridictions faiblement imposées. Résultat, les gouvernements se retrouvent privés de recettes fiscales (à hauteur de 240 milliards $ chaque année), les entreprises locales doivent rivaliser selon des règles du jeu inéquitables contre des multinationales moins imposées qu’elles, de même que les travailleurs – aux revenus moins mobiles et plus faciles à auditer – doivent payer des impôts plus élevés puisque leur pays s’efforce de compenser les recettes non perçues.
L’accord de 2021 était censé mettre fin à tout cela. Le temps que les négociations s’achèvent, il avait néanmoins déjà été vidé de sa substance, au point de n’aboutir qu’à peu de recettes supplémentaires pour les pays en voie de développement.
L’impôt minimum était par exemple supposé être renforcé par un ensemble de règles imbriquées visant à déterminer quel État était en droit de taxer les bénéfices sous-imposés des multinationales. Seulement voilà, en pratique, l’organisation de ces règles a fait en sorte que l’essentiel des recettes soit collecté soit par les pays d’immatriculation (principalement les grandes économies développées), soit par des paradis fiscaux tels que l’Irlande, la Suisse ou Singapour, qui ont seulement fait passer à 15 % leurs taux d’imposition extraordinairement faibles.
Le passage d’un monde sans impôt minimum à un plancher de 15 % peut sembler constituer un pas en avant. Or, tout à toujours laissé à craindre que ce minimum peu élevé devienne la nouvelle norme, c’est-à-dire qu’une réforme censée placer plus haut la barre finisse en réalité par l’abaisser. Et dans la mesure où les pays en voie de développement recourent comparativement davantage aux recettes de l’impôt sur les sociétés, il était à prévoir que ces États finissent grands perdants.
La règle régissant par exemple la réorientation des droits de percevoir l’impôt ne s’appliquerait qu’à un petit nombre de multinationales, et à moins d’un quart de leurs bénéfices, l’essentiel des profits demeurant soumis à l’actuel régime des prix de transfert. Or, la raisonnement à l’appui de cette division demeure obscur, dans la mesure où les bénéfices d’entreprise déclarés dans la quasi-totalité des juridictions incluent déjà les déductions du coût du capital et des intérêts. Il s’agit de bénéfices purs résultant de l’exploitation conjointe des activités mondiales des multinationales.
Par conséquent, non seulement l’accord de 2021 mésentend-il l’économie de l’imposition des bénéfices des sociétés, mais il renforce également les inégalités mondiales en ne conférant que peu de recettes à des pays en voie de développement pourtant actuellement confrontés au parfait désastre d’une crise à la fois énergétique, alimentaire et de la dette. Le fait que les États prennent eux-mêmes les choses en main en dit long sur la fragilité du consensus actuel et sur la nécessité de davantage de réformes.
Les pays riches ont toujours eu tendance à entraver les efforts des pays en voie de développement visant à jouer un rôle actif dans la détermination des règles du jeu internationales. Autour de la table, il ne suffit pas de laisser un chaise libre aux représentants du Sud global. Ce qui importe, c’est que les autres négociateurs présents écoutent et répondent de manière significative à leurs préoccupations. Les dirigeants mondiaux doivent tenir compte des demandes des pays en voie de développement, et convenir d’une nouvelle ronde de négociations, plus inclusive, afin de parvenir à une réforme fiscale mondiale plus équitable et plus durable.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie, est professeur à l’Université de Columbia, et coprésident de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés. Tommaso Faccio est directeur du secrétariat de la Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés.
© Project Syndicate 1995–2023



 chroniques
chroniques