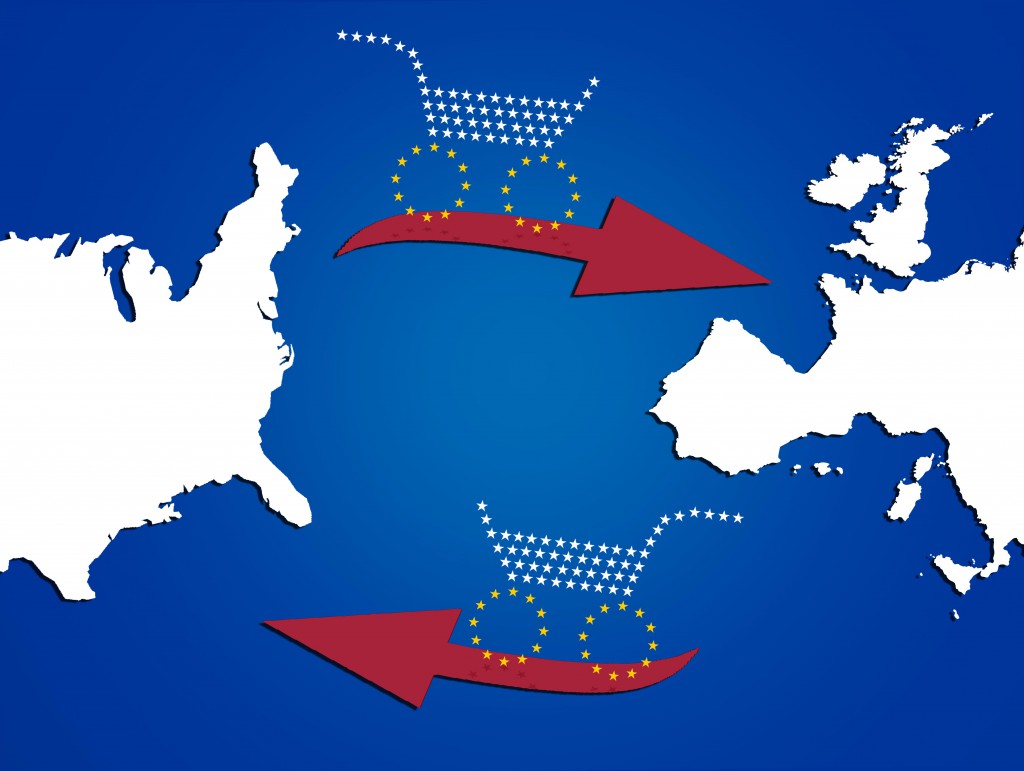Ce nouveau consensus est succinctement exposé par Nouriel Roubini : la réaction contre la mondialisation « peut être contenue et contrôlée par des mesures de compensation en faveur des travailleurs qui en sont les victimes collatérales », affirme-t-il. « C’est seulement par la mise en œuvre de ces mesures que les perdants de la mondialisation commenceront à penser qu’ils peuvent passer du côté des gagnants. »
L’argument paraît éminemment sensé, tant du point de vue économique que politique. Les économistes savent de longue main que la libération des échanges induit une redistribution des revenus et, pour certains groupes, des pertes nettes, même si elle grossit la part de gâteau à laquelle peut prétendre l’économie d’un pays. Ainsi les accords commerciaux n’améliorent-ils véritablement la prospérité nationale qu’à condition que les gagnants dédommagent les perdants. Ces compensations assurent aussi à l’ouverture commerciale le soutien d’une part plus importante de l’électorat et sont donc de bonne politique.
Avant la naissance de l’État-providence, la tension entre ouverture et redistribution était résolue soit par l’émigration à grande échelle de la main-d’œuvre, soit par le recours à des mesures protectionnistes, notamment dans le domaine agricole. Avec le développement de l’État-providence, ces contraintes se firent moins pesantes, ce qui permit la libéralisation des échanges. Aujourd’hui, les pays avancés les plus ouverts aux marchés internationaux sont aussi ceux où les filets de sécurité et les programmes de protection sociale – l’État-providence – sont les plus développés. Des enquêtes en Europe ont montré que les perdants de la mondialisation au sein d’un pays sont généralement favorables au renforcement des programmes sociaux et de la régulation du marché du travail.
Si l’oppositions aux échanges n’est pas devenue plus active dans l’Europe d’aujourd’hui, c’est en partie parce que les protections sociales y demeurent importantes, même si elles ont régressé ces dernières années. Il n’est pas exagéré de dire qu’État-providence et économie ouverte ont formé, pendant une bonne part du XXe siècle l’avers et le revers de la même médaille.
Comparés à la plupart des pays européens, les États-Unis sont des nouveaux-venus dans la mondialisation. Récemment encore, leur vaste marché intérieur et leur relatif isolement géographique leur ont fourni une protection quasi naturelle face aux importations, notamment des pays où la main-d’œuvre est bon marché. Ils n’ont pas non plus mis en place un État-providence très développé.
Lorsque les États-Unis ont commencé à s’ouvrir aux importations provenant du Mexique, de la Chine et d’autres pays en développement, dans les années 1980, on aurait pu s’attendre à les voir emprunter la voie européenne. Il n’en fut rien. Emmenés par les Reaganomics et les idées des fondamentalistes du marché, ils sont partis dans la direction opposée. Comme le note Larry Mischel, président de l’Economic Policy Institute : « On ignora les perdants. Ce fut un choix délibéré ». En 1981, poursuit-il, le « programme d’aide à l’ajustement lié aux échanges [Trade Adjustment Assistance – TAA], fut une des premières choses auxquelles s’en prit Reagan, en diminuant les indemnisations hebdomadaires ».
Le mal ne cessa pas avec les administrations démocrates ultérieures. Pour reprendre les termes de Mischel : « Si les partisans du libre-échange s’étaient réellement souciés des classes laborieuses, ils auraient pu soutenir toutes sortes de mesures favorisant le plein-emploi, la négociation collective, l’amélioration des conditions de travail, la hausse du salaire minimum, etc., qui auraient garanti la croissance régulière des salaires. » Et tout cela aurait pu être réalisé « avant d’administrer les “ chocs ” qui ont résulté de l’expansion des échanges avec les pays à faible coûts de main-d’œuvre.
Les États-Unis pourraient-ils, aujourd’hui, faire marche arrière, et suivre la nouvelle doxa émergente ? En 2007, déjà, le politologue Ken Scheve et l’économiste Matt Slaughter appelaient de leurs vœux g un « New Deal de la mondialisation » aux États-Unis, qui aurait conditionné « l’insertion dans l’économie mondiale à une redistribution substantielle des revenus ». Ce qui nécessitait, selon eux, l’adoption d’un système fédéral d’imposition beaucoup plus progressif.
Slaughter avait été en poste dans l’administration républicaine, sous le mandat du président George W. Bush. Il serait impossible aujourd’hui d’imaginer que ce genre de proposition puisse venir des milieux républicains. C’est dire à quel point la vie politique américaine est désormais polarisée. Les efforts de Trump et de ses alliés au Congrès pour vider de sa substance le régime d’assurance santé porté par son prédécesseur, le président Barack Obama, traduisent parfaitement l’ambition des Rébublicains, non pas d’étendre la protection sociale, mais de la restreindre.
Le consensus actuel sur la nécessité de dédommager les perdants de la mondialisation suppose que les gagnants soient mus par leur intérêt éclairé – qu’ils considèrent les compensations accordées aux perdants comme essentielles au maintien de l’ouverture économique. La présidence Trump révèle un tout autre point de vue : la mondialisation, telle du moins qu’elle s’exprime actuellement, fait pencher la balance du pouvoir politique vers ceux dont les biens et le rang leur permettent de tirer profit de l’ouverture, sapant toute influence organisée qu’auraient pu avoir, dans un premier temps, les perdants. Le mécontentement diffus créé par la mondialisation peut aisément être canalisé, Trump l’a bien montré, pour servir des intérêts tout différents, en phase avec ceux des élites.
Les mesures de dédommagement sont toujours sujettes au problème de ce que les économistes nomment l’« incohérence temporelle ». Avant qu’une nouvelle politique ne soit mise en œuvre – un accord commercial, par exemple –, ses bénéficiaires sont enclins aux programmes de dédommagement, mais lorsque cette politique est adoptée et pratiquée, ils n’ont plus guère intérêt à les poursuivre, soit parce que le réajustement est globalement coûteux, soit parce qu’au fond la balance du pouvoir a déjà penché en leur faveur.
Le temps n’est plus au dédommagement. Même s’il constituait, voici vingt ans, une méthode viable, il ne peut plus fournir une réponse pratique aux effets négatifs de la mondialisation. Pour convaincre les perdants, ce sont les règles mêmes de la mondialisation que nous devons envisager de changer.
Traduction François Boisivon
Dani Rodrik, professeur d’économie politique internationale à la John F. Kennedy School of Government de l’université d’Harvard, est l’auteur de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science (« Les règles de l’économie : les raisons et les torts de de la pseudo-science »).
L’argument paraît éminemment sensé, tant du point de vue économique que politique. Les économistes savent de longue main que la libération des échanges induit une redistribution des revenus et, pour certains groupes, des pertes nettes, même si elle grossit la part de gâteau à laquelle peut prétendre l’économie d’un pays. Ainsi les accords commerciaux n’améliorent-ils véritablement la prospérité nationale qu’à condition que les gagnants dédommagent les perdants. Ces compensations assurent aussi à l’ouverture commerciale le soutien d’une part plus importante de l’électorat et sont donc de bonne politique.
Avant la naissance de l’État-providence, la tension entre ouverture et redistribution était résolue soit par l’émigration à grande échelle de la main-d’œuvre, soit par le recours à des mesures protectionnistes, notamment dans le domaine agricole. Avec le développement de l’État-providence, ces contraintes se firent moins pesantes, ce qui permit la libéralisation des échanges. Aujourd’hui, les pays avancés les plus ouverts aux marchés internationaux sont aussi ceux où les filets de sécurité et les programmes de protection sociale – l’État-providence – sont les plus développés. Des enquêtes en Europe ont montré que les perdants de la mondialisation au sein d’un pays sont généralement favorables au renforcement des programmes sociaux et de la régulation du marché du travail.
Si l’oppositions aux échanges n’est pas devenue plus active dans l’Europe d’aujourd’hui, c’est en partie parce que les protections sociales y demeurent importantes, même si elles ont régressé ces dernières années. Il n’est pas exagéré de dire qu’État-providence et économie ouverte ont formé, pendant une bonne part du XXe siècle l’avers et le revers de la même médaille.
Comparés à la plupart des pays européens, les États-Unis sont des nouveaux-venus dans la mondialisation. Récemment encore, leur vaste marché intérieur et leur relatif isolement géographique leur ont fourni une protection quasi naturelle face aux importations, notamment des pays où la main-d’œuvre est bon marché. Ils n’ont pas non plus mis en place un État-providence très développé.
Lorsque les États-Unis ont commencé à s’ouvrir aux importations provenant du Mexique, de la Chine et d’autres pays en développement, dans les années 1980, on aurait pu s’attendre à les voir emprunter la voie européenne. Il n’en fut rien. Emmenés par les Reaganomics et les idées des fondamentalistes du marché, ils sont partis dans la direction opposée. Comme le note Larry Mischel, président de l’Economic Policy Institute : « On ignora les perdants. Ce fut un choix délibéré ». En 1981, poursuit-il, le « programme d’aide à l’ajustement lié aux échanges [Trade Adjustment Assistance – TAA], fut une des premières choses auxquelles s’en prit Reagan, en diminuant les indemnisations hebdomadaires ».
Le mal ne cessa pas avec les administrations démocrates ultérieures. Pour reprendre les termes de Mischel : « Si les partisans du libre-échange s’étaient réellement souciés des classes laborieuses, ils auraient pu soutenir toutes sortes de mesures favorisant le plein-emploi, la négociation collective, l’amélioration des conditions de travail, la hausse du salaire minimum, etc., qui auraient garanti la croissance régulière des salaires. » Et tout cela aurait pu être réalisé « avant d’administrer les “ chocs ” qui ont résulté de l’expansion des échanges avec les pays à faible coûts de main-d’œuvre.
Les États-Unis pourraient-ils, aujourd’hui, faire marche arrière, et suivre la nouvelle doxa émergente ? En 2007, déjà, le politologue Ken Scheve et l’économiste Matt Slaughter appelaient de leurs vœux g un « New Deal de la mondialisation » aux États-Unis, qui aurait conditionné « l’insertion dans l’économie mondiale à une redistribution substantielle des revenus ». Ce qui nécessitait, selon eux, l’adoption d’un système fédéral d’imposition beaucoup plus progressif.
Slaughter avait été en poste dans l’administration républicaine, sous le mandat du président George W. Bush. Il serait impossible aujourd’hui d’imaginer que ce genre de proposition puisse venir des milieux républicains. C’est dire à quel point la vie politique américaine est désormais polarisée. Les efforts de Trump et de ses alliés au Congrès pour vider de sa substance le régime d’assurance santé porté par son prédécesseur, le président Barack Obama, traduisent parfaitement l’ambition des Rébublicains, non pas d’étendre la protection sociale, mais de la restreindre.
Le consensus actuel sur la nécessité de dédommager les perdants de la mondialisation suppose que les gagnants soient mus par leur intérêt éclairé – qu’ils considèrent les compensations accordées aux perdants comme essentielles au maintien de l’ouverture économique. La présidence Trump révèle un tout autre point de vue : la mondialisation, telle du moins qu’elle s’exprime actuellement, fait pencher la balance du pouvoir politique vers ceux dont les biens et le rang leur permettent de tirer profit de l’ouverture, sapant toute influence organisée qu’auraient pu avoir, dans un premier temps, les perdants. Le mécontentement diffus créé par la mondialisation peut aisément être canalisé, Trump l’a bien montré, pour servir des intérêts tout différents, en phase avec ceux des élites.
Les mesures de dédommagement sont toujours sujettes au problème de ce que les économistes nomment l’« incohérence temporelle ». Avant qu’une nouvelle politique ne soit mise en œuvre – un accord commercial, par exemple –, ses bénéficiaires sont enclins aux programmes de dédommagement, mais lorsque cette politique est adoptée et pratiquée, ils n’ont plus guère intérêt à les poursuivre, soit parce que le réajustement est globalement coûteux, soit parce qu’au fond la balance du pouvoir a déjà penché en leur faveur.
Le temps n’est plus au dédommagement. Même s’il constituait, voici vingt ans, une méthode viable, il ne peut plus fournir une réponse pratique aux effets négatifs de la mondialisation. Pour convaincre les perdants, ce sont les règles mêmes de la mondialisation que nous devons envisager de changer.
Traduction François Boisivon
Dani Rodrik, professeur d’économie politique internationale à la John F. Kennedy School of Government de l’université d’Harvard, est l’auteur de Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science (« Les règles de l’économie : les raisons et les torts de de la pseudo-science »).


 chroniques
chroniques