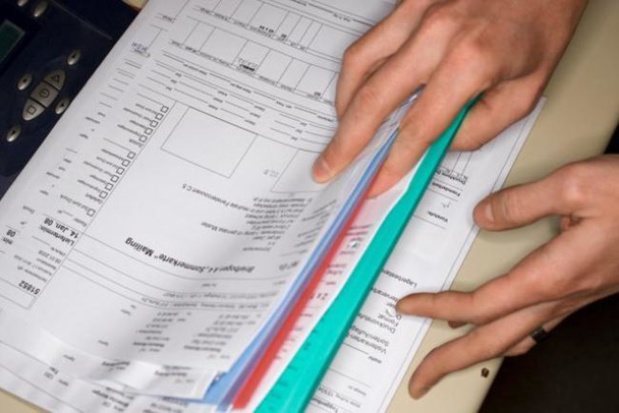L’argument est absurde : c’est l’Amérique, après tout, et plus exactement l’Amérique des entreprises, qui a tenu la plume lorsqu’on été rédigées les règles de la mondialisation.
Cela dit, l’un des aspects les plus toxiques de la mondialisation n’a pas reçu l’attention qu’il méritait : l’évasion fiscale des entreprises. Les multinationales ne peuvent que trop facilement relocaliser leur siège et leur production dans les pays qui pratiquent les prélèvements les plus bas. Et elles n’ont pas même besoin, dans certains cas, de déménager leurs activités commerciales, car elles peuvent simplement jouer sur leurs « écritures » comptables.
Ainsi Starbucks peut-elle poursuivre son développement au Royaume-Uni tout en y payant pour ainsi dire aucun impôt, au prétexte que ses bénéfices y sont des plus réduits. Mais si c’était vrai, s’y développer n’aurait aucun sens. Pourquoi renforcer votre présence si vous ne pouvez en attendre aucun profit ? Ces bénéfices existent, bien sûr, mais ils sont aspirés hors du Royaume-Uni, sous forme de redevances, de droits de franchise ou d’autres charges, vers des pays où les impôts sont moins élevés.
Pour les firmes les plus avisées, ce genre d’évasion fiscale est devenu un art. Apple, par exemple, y excelle. Les coûts confondus de ces pratiques sont énormes. Selon le Fonds monétaire international, la puissance publique perd au moins 500 milliards de dollars annuels en raison des transferts d’impôts des entreprises. Gabriel Zucman, de l’université de Californie à Berkeley, et ses collègues estiment quant à eux qu’environ 40 % des profits réalisés par les multinationales américaines à l’étranger sont transférés vers des paradis fiscaux. En 2018, 60 des 500 premières entreprises du pays – parmi lesquelles Amazon, Netflix et General Motors – n’y ont pas payé d’impôts, malgré des bénéfices cumulés annoncés (au niveau mondial) à hauteur de 80 milliards de dollars. Ces dérives ont un effet dévastateur sur les recettes fiscales nationales et sapent l’idée même d’équité.
Depuis les retombées de la crise financière de 2008, de nombreux pays s’étant alors trouvés à la dernière extrémité financière, les demandes de refonte du régime mondial d’imposition des multinationales se sont multipliées. L’action d’envergure aujourd’hui menée par l’OCDE avec le Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) a déjà porté de beaux fruits et fait régresser les pratiques les plus préjudiciables, notamment celles qui concernent les prêts d’une filiale à une autre. Mais comme le montrent les données, les efforts entrepris sont loin d’être suffisants.
Le grand problème du BEPS est qu’il n’offre que des remèdes dispersés à un statu quo fondamentalement bancal et irréformable. Avec le « système de des prix de transfert » actuellement en vigueur, deux filiales de la même multinationale peuvent échanger des biens et des services par-delà les frontières et valoriser la transaction au « prix de pleine concurrence » lors de leur déclaration à l’administration fiscale de leurs revenus et bénéfices. Le prix qu’elles présentent serait, prétendent-elles, celui de ces biens et de ces services s’ils étaient échangés sur un marché concurrentiel.
Pour des raisons évidentes, ce système n’a jamais bien fonctionné. Comment fixer la valeur d’une voiture sans moteur ou d’une chemise sans boutons ? Il n’existe pas dans ce domaine de prix de pleine concurrence ni de marchés concurrentiels auxquels une firme puisse se référer. Et les choses deviennent encore plus compliquées dans le secteur en pleine expansion des services : comment peut-on valoriser un procès de production sans y inclure les services de direction fournis par le siège ?
La capacité des multinationales à tirer profit du système des prix de transfert n’a fait que croître, à mesure que se sont accrus les échanges entre sociétés, que se sont développés les échanges de services (plutôt que de biens), que s’est renforcée l’importance de la propriété intellectuelle et que les entreprises sont devenues de plus en plus habiles dans l’exploitation du système. On connaît le résultat : le transfert de profits à grande échelle d’un pays et d’une juridiction à l’autre, avec la baisse des recettes fiscales qui s’ensuit.
Il est révélateur que les firmes américaines ne soient pas autorisées à utiliser le système des prix de transfert pour allouer ici ou là à l’intérieur des États-Unis leurs bénéfices. Cela nécessiterait qu’on réévalue sans cesse les prix des biens à mesure qu’ils traversent et retraversent les frontières des États. Au contraire, la taxation des bénéfices des entreprises est répartie entre les États en utilisant une formule qui prend en compte l’emploi, les ventes, les actifs possédés dans chaque État. Et, comme le montre dans son nouveau rapport l’Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés – dont je suis membre), cette approche est la seule qui puisse fonctionner au niveau mondial.
Pour sa part, l’OCDE s’apprête à rendre publique une proposition importante, qui pourrait faire un peu bouger le cadre actuel dans cette direction. Mais si les informations qui circulent concernant ce à quoi ressemblera cette proposition sont exactes, elle n’ira pas encore suffisamment loin. Si elle est adoptée, les revenus d’une société continueront d’être traités, pour l’essentiel, en utilisant le système des prix de transfert, seule une part « résiduelle » étant allouée au moyen d’une formule équilibrée. Les raisons avancées pour le maintien de cette distinction ne sont pas claires ; le moins qu’on puisse dire est que l’OCDE sanctifie l’approche graduelle.
À vrai dire, les bénéfices déclarés des entreprises déduisent déjà dans presque toutes les juridictions le coût du capital et les intérêts. Ces « résiduels » – ou purs profits – proviennent des opérations combinées des activités d’une multinationale au niveau mondial. Ainsi, au titre de la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi aux États-Unis, le coût total des biens de production est déductible en plus d’une part des intérêts, ce qui permet au total des bénéfices déclarés d’être substantiellement inférieur aux véritables bénéfices économiques.
Étant donné l’échelle du problème, il est évident qu’un taux minimum d’imposition est nécessaire pour mettre un terme à la course au moins-disant (qui ne bénéficie qu’aux entreprises et à elles seules). Rien ne prouve qu’une baisse globale de l’imposition conduise à une hausse des investissements. (Certes, lorsqu’un pays abaisse son taux d’imposition en comparaison des autres, il peut « voler » une part de l’investissement, mais cette méthode d’appauvrissement de son voisin n’est pas pertinente à l’échelle mondiale.) Ce taux d’imposition minimum global devrait être fixé à une hauteur comparable à la moyenne actuelle du taux d’imposition effectif des sociétés, qui est d’environ 25 %. Faute de quoi les taux d’imposition mondiaux des sociétés convergeront vers le minimum et ce qui était conçu comme une réforme pour augmenter l’impôt des multinationales finira par n’obtenir que l’effet contraire.
Le monde doit faire face à de multiples crises – parmi lesquelles le changement climatique, le creusement des inégalités, le ralentissement de la croissance et le vieillissement des infrastructures – dont aucune ne peut être résolue sans des pouvoirs publics dotés de moyens conséquents. Malheureusement, les propositions actuelles de réforme de la fiscalité mondiale ne vont pas, à l’évidence, assez loin. Les multinationales doivent être rappelées à l’effort collectif.
Traduit de l’anglais par François Boisivon
Joseph E. Stiglitz, lauréat du Nobel d’économie, est professeur d’université à Columbia et chef économiste du Roosevelt Institute. Il est l’auteur, pour son ouvrage le plus récent, de Peuple, pouvoir et profits. Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale (Les Liens qui libèrent).
© Project Syndicate 1995–2019
Cela dit, l’un des aspects les plus toxiques de la mondialisation n’a pas reçu l’attention qu’il méritait : l’évasion fiscale des entreprises. Les multinationales ne peuvent que trop facilement relocaliser leur siège et leur production dans les pays qui pratiquent les prélèvements les plus bas. Et elles n’ont pas même besoin, dans certains cas, de déménager leurs activités commerciales, car elles peuvent simplement jouer sur leurs « écritures » comptables.
Ainsi Starbucks peut-elle poursuivre son développement au Royaume-Uni tout en y payant pour ainsi dire aucun impôt, au prétexte que ses bénéfices y sont des plus réduits. Mais si c’était vrai, s’y développer n’aurait aucun sens. Pourquoi renforcer votre présence si vous ne pouvez en attendre aucun profit ? Ces bénéfices existent, bien sûr, mais ils sont aspirés hors du Royaume-Uni, sous forme de redevances, de droits de franchise ou d’autres charges, vers des pays où les impôts sont moins élevés.
Pour les firmes les plus avisées, ce genre d’évasion fiscale est devenu un art. Apple, par exemple, y excelle. Les coûts confondus de ces pratiques sont énormes. Selon le Fonds monétaire international, la puissance publique perd au moins 500 milliards de dollars annuels en raison des transferts d’impôts des entreprises. Gabriel Zucman, de l’université de Californie à Berkeley, et ses collègues estiment quant à eux qu’environ 40 % des profits réalisés par les multinationales américaines à l’étranger sont transférés vers des paradis fiscaux. En 2018, 60 des 500 premières entreprises du pays – parmi lesquelles Amazon, Netflix et General Motors – n’y ont pas payé d’impôts, malgré des bénéfices cumulés annoncés (au niveau mondial) à hauteur de 80 milliards de dollars. Ces dérives ont un effet dévastateur sur les recettes fiscales nationales et sapent l’idée même d’équité.
Depuis les retombées de la crise financière de 2008, de nombreux pays s’étant alors trouvés à la dernière extrémité financière, les demandes de refonte du régime mondial d’imposition des multinationales se sont multipliées. L’action d’envergure aujourd’hui menée par l’OCDE avec le Cadre inclusif sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) a déjà porté de beaux fruits et fait régresser les pratiques les plus préjudiciables, notamment celles qui concernent les prêts d’une filiale à une autre. Mais comme le montrent les données, les efforts entrepris sont loin d’être suffisants.
Le grand problème du BEPS est qu’il n’offre que des remèdes dispersés à un statu quo fondamentalement bancal et irréformable. Avec le « système de des prix de transfert » actuellement en vigueur, deux filiales de la même multinationale peuvent échanger des biens et des services par-delà les frontières et valoriser la transaction au « prix de pleine concurrence » lors de leur déclaration à l’administration fiscale de leurs revenus et bénéfices. Le prix qu’elles présentent serait, prétendent-elles, celui de ces biens et de ces services s’ils étaient échangés sur un marché concurrentiel.
Pour des raisons évidentes, ce système n’a jamais bien fonctionné. Comment fixer la valeur d’une voiture sans moteur ou d’une chemise sans boutons ? Il n’existe pas dans ce domaine de prix de pleine concurrence ni de marchés concurrentiels auxquels une firme puisse se référer. Et les choses deviennent encore plus compliquées dans le secteur en pleine expansion des services : comment peut-on valoriser un procès de production sans y inclure les services de direction fournis par le siège ?
La capacité des multinationales à tirer profit du système des prix de transfert n’a fait que croître, à mesure que se sont accrus les échanges entre sociétés, que se sont développés les échanges de services (plutôt que de biens), que s’est renforcée l’importance de la propriété intellectuelle et que les entreprises sont devenues de plus en plus habiles dans l’exploitation du système. On connaît le résultat : le transfert de profits à grande échelle d’un pays et d’une juridiction à l’autre, avec la baisse des recettes fiscales qui s’ensuit.
Il est révélateur que les firmes américaines ne soient pas autorisées à utiliser le système des prix de transfert pour allouer ici ou là à l’intérieur des États-Unis leurs bénéfices. Cela nécessiterait qu’on réévalue sans cesse les prix des biens à mesure qu’ils traversent et retraversent les frontières des États. Au contraire, la taxation des bénéfices des entreprises est répartie entre les États en utilisant une formule qui prend en compte l’emploi, les ventes, les actifs possédés dans chaque État. Et, comme le montre dans son nouveau rapport l’Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les sociétés – dont je suis membre), cette approche est la seule qui puisse fonctionner au niveau mondial.
Pour sa part, l’OCDE s’apprête à rendre publique une proposition importante, qui pourrait faire un peu bouger le cadre actuel dans cette direction. Mais si les informations qui circulent concernant ce à quoi ressemblera cette proposition sont exactes, elle n’ira pas encore suffisamment loin. Si elle est adoptée, les revenus d’une société continueront d’être traités, pour l’essentiel, en utilisant le système des prix de transfert, seule une part « résiduelle » étant allouée au moyen d’une formule équilibrée. Les raisons avancées pour le maintien de cette distinction ne sont pas claires ; le moins qu’on puisse dire est que l’OCDE sanctifie l’approche graduelle.
À vrai dire, les bénéfices déclarés des entreprises déduisent déjà dans presque toutes les juridictions le coût du capital et les intérêts. Ces « résiduels » – ou purs profits – proviennent des opérations combinées des activités d’une multinationale au niveau mondial. Ainsi, au titre de la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi aux États-Unis, le coût total des biens de production est déductible en plus d’une part des intérêts, ce qui permet au total des bénéfices déclarés d’être substantiellement inférieur aux véritables bénéfices économiques.
Étant donné l’échelle du problème, il est évident qu’un taux minimum d’imposition est nécessaire pour mettre un terme à la course au moins-disant (qui ne bénéficie qu’aux entreprises et à elles seules). Rien ne prouve qu’une baisse globale de l’imposition conduise à une hausse des investissements. (Certes, lorsqu’un pays abaisse son taux d’imposition en comparaison des autres, il peut « voler » une part de l’investissement, mais cette méthode d’appauvrissement de son voisin n’est pas pertinente à l’échelle mondiale.) Ce taux d’imposition minimum global devrait être fixé à une hauteur comparable à la moyenne actuelle du taux d’imposition effectif des sociétés, qui est d’environ 25 %. Faute de quoi les taux d’imposition mondiaux des sociétés convergeront vers le minimum et ce qui était conçu comme une réforme pour augmenter l’impôt des multinationales finira par n’obtenir que l’effet contraire.
Le monde doit faire face à de multiples crises – parmi lesquelles le changement climatique, le creusement des inégalités, le ralentissement de la croissance et le vieillissement des infrastructures – dont aucune ne peut être résolue sans des pouvoirs publics dotés de moyens conséquents. Malheureusement, les propositions actuelles de réforme de la fiscalité mondiale ne vont pas, à l’évidence, assez loin. Les multinationales doivent être rappelées à l’effort collectif.
Traduit de l’anglais par François Boisivon
Joseph E. Stiglitz, lauréat du Nobel d’économie, est professeur d’université à Columbia et chef économiste du Roosevelt Institute. Il est l’auteur, pour son ouvrage le plus récent, de Peuple, pouvoir et profits. Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale (Les Liens qui libèrent).
© Project Syndicate 1995–2019

 chroniques
chroniques